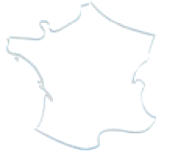Vassivière : mémoire engloutie d’un lac de la Creuse

Sous les eaux tranquilles du lac de Vassivière sommeille un monde disparu : celui des hameaux creusois engloutis au nom du progrès en 1950.
Genèse d’un paysage artificiel
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France des Trente Glorieuses s’engage dans une modernisation de grande ampleur. Parmi les grands chantiers de cette époque, la construction du barrage de Vassivière répondait à un besoin double : produire de l’électricité par la force hydraulique et garantir l’approvisionnement en eau de la région de Limoges. Le projet, lancé en 1946, se déploie sur quatre ans. La Maulde, paisible affluent de la Vienne, est déviée, disciplinée, contenue. Le gigantisme de l’ouvrage — 233 mètres de long, 32 mètres de haut — témoigne de la puissance d’une époque qui voulait plier la nature à ses ambitions.
Mais cette métamorphose ne fut pas sans douleurs. La création du lac impliquait la submersion de plusieurs hameaux, dont celui de Vassivière, appelé à donner son nom au plan d’eau. En 1950, alors que la mise en eau est lancée à Noël, des familles sont contraintes de quitter leurs maisons, leurs terres, leurs cimetières. Les souvenirs, les toits, les silences ruraux disparaissent sans qu’on prenne toujours soin de les consigner. « C’était notre terre, notre histoire », disent encore ceux qui, enfants, ont vu leur village englouti sans retour.
Le barrage alimente la centrale du Mazet, édifiée en souterrain, dotée de turbines Francis capables de produire près de 64 MW. Loin d’être un simple réservoir, Vassivière s’inscrit dans une logique nationale de maîtrise de l’énergie. EDF devient le maître d’ouvrage d’un territoire que l’on désire utile, performant, transformé. La Creuse, longtemps isolée, entre dans l’ère de l’utilité publique au prix de sacrifices intimes.
D’un lac utile à un espace de vie
Avec le temps, la nature a repris ses droits, autrement. Les eaux sombres du lac ont vu fleurir une faune nouvelle. Loutres, hérons cendrés, martins-pêcheurs et autres rapaces s’y sont installés. Près de 200 espèces d’oiseaux y sont recensées, transformant ce désert aquatique en sanctuaire. Sous les frondaisons nouvelles des hêtres et chênes, les mammifères reprennent leurs courses, comme si le tumulte humain s’était enfin tus. Le lac, pensé comme infrastructure, devient paysage.
Le lac de Vassivière, avec ses 45 km de rives, offre aujourd’hui cinq plages surveillées, des bases nautiques, des sentiers de randonnées balisés, et même un service de bateau-taxi. Chaque été, des milliers de vacanciers convergent vers ce lieu, à cheval sur la Creuse et la Haute-Vienne, pour retrouver une forme de nature apaisée. Les villages voisins ont vu renaître une économie de l’accueil : gîtes, artisans, festivals. Ce qui fut lieu de perte devient point d’attraction, de convergence.
Au centre du lac, l’île de Vassivière est devenue en 1992 un haut lieu d’art contemporain. L’Institut international qui s’y est installé accueille expositions, résidences, et installations monumentales. Le visiteur déambule entre forêt et création plastique, dans un espace où les oeuvres dialoguent avec les souvenirs immergés. Vassivière n’oublie pas : elle transforme. L’art, ici, devient une façon d’habiter les absences.
Les persistances de la mémoire
Ceux qui vivaient dans la vallée avant 1950 portent encore les noms de lieux disparus. Vassivière, Masgrangeas, Broussas : autant de toponymes aujourd’hui noyés, que les anciens égrènent comme une litanie. Chaque pierre engloutie est une histoire perdue. Les familles ont parfois érigé des stèles mémorielles sur les berges, rappelant qu’ici, il y avait des vies, des écoles, des foires, des morts. Le silence de l’eau recouvre, mais n’efface pas.
L’arrivée du chantier a bouleversé les équilibres locaux. La commune de Peyrat-le-Château a vu sa population temporairement quadrupler, accueillant ouvriers, ingénieurs, familles. Le bourg s’est transformé en cité provisoire, parfois chaotique, avec ses tensions, ses solidarités nouvelles, ses incompréhensions. Une mémoire ouvrière s’est superposée à la mémoire paysanne. Aujourd’hui encore, ces couches historiques cohabitent, parfois sans se réconcilier.
Vassivière interroge la manière dont une nation pense ses transformations. Faut-il oublier pour avancer, ou transmettre ce qui fut sacrifié ? Les jeunes générations, qui profitent du lac sans toujours connaître son passé, croisent parfois les regards silencieux de ceux dont les souvenirs sont ensevelis sous les flots. Entre deux mondes, un pont fragile subsiste : celui du récit, de la transmission orale, et de quelques stèles dressées sur la berge comme des balises pour les mémoires en quête d’écho.