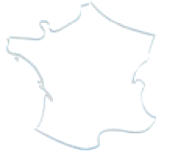Narcotrafic : des outre-mer en première ligne face aux réseaux internationaux

Isolés, exposés, et longtemps sous-dotés : plusieurs territoires ultramarins se retrouvent aujourd’hui au cœur des routes mondiales de la drogue, sans disposer des moyens nécessaires pour endiguer ce phénomène qui bouleverse leurs sociétés. Alors que l’assassinat à Marseille de Mehdi Kessaci a ravivé l’ampleur du narcotrafic dans l’Hexagone, élus et acteurs locaux rappellent que la pression est tout aussi lourde dans les outre-mer, parfois même plus.
Des territoires devenus des carrefours mondiaux
Lors d’un débat organisé au congrès de l’Association des maires de France, la sénatrice martiniquaise Catherine Conconne a résumé l’inquiétude partagée par de nombreux élus ultramarins : les trafics, traditionnellement dirigés vers les États-Unis, se réorientent massivement vers l’Europe, et les départements d’outre-mer se retrouvent sur ces nouvelles routes stratégiques.
La Martinique en offre une illustration frappante. Depuis le début de l’année, près de 30 tonnes de stupéfiants ont été saisies, un volume révélateur de l’ampleur du marché. Le 12 novembre, une cache a été découverte à Fort-de-France, contenant drogue et armes de guerre – une combinaison qui alimente la hausse des violences. Trente-quatre personnes y ont déjà perdu la vie en 2025 dans des affaires liées au narcotrafic.
Pour Marcellin Nadeau, député GDR, les raisons de cette explosion criminelle sont aussi sociales : « La pauvreté et les inégalités créent un terreau propice aux trafics. » Il dénonce un État trop focalisé sur la lutte contre les flux à destination de l’Europe, et qui néglige la prise en charge des ravages locaux, pourtant visibles à chaque coin de rue.
Guyane : une proximité avec les pays producteurs qui fragilise toute la société
La situation est encore plus préoccupante en Guyane, où la frontière directe avec plusieurs pays producteurs place le territoire dans une position hautement vulnérable. « La Guyane est devenue une plaque tournante, et cela déséquilibre profondément la société », alerte Sandra Trochimara, maire de Cayenne.
Depuis le grand mouvement social de 2017, les élus réclament des moyens renforcés. L’État a promis beaucoup : maintien d’un escadron de gendarmerie mobile, renforts de police, nouvel équipement de surveillance à l’aéroport, construction d’un tribunal et d’un centre pénitentiaire à Saint-Laurent-du-Maroni, cité judiciaire à Cayenne… Malgré ces avancées, la délinquance continue de progresser.
Pour les responsables locaux, le décalage entre les promesses et la réalité alimente un sentiment d’abandon. La pression criminelle reste forte, et les acteurs de terrain redoutent que la situation ne s’enkyste durablement.
À La Réunion, un territoire de transit sous-protégé
Dans l’océan Indien, La Réunion commence à vivre le même scénario. L’île ne produit pas de stupéfiants, mais elle subit le passage régulier de “mules” arrivant des Antilles ou de Guyane. Malgré cette montée des risques, les moyens judiciaires et policiers y sont inférieurs à ceux de la métropole : un tiers de policiers en moins, un tiers de procureurs en moins, rappelle la députée Émeline K/Bidi.
Selon elle, le gouvernement entretient une vision « stigmatisante » des outre-mer, perçus avant tout comme des portes d’entrée vers la France continentale – mais jamais comme des territoires confrontés à leurs propres enjeux sécuritaires. « On nous identifie comme un problème, mais on ne nous donne pas les outils pour protéger la population », résume-t-elle.
Certaines décisions aggraveraient même les difficultés, comme les interdictions de port ou d’aéroport imposées aux personnes condamnées. « Des mules arrêtées à La Réunion ne peuvent plus quitter l’île. On concentre la criminalité localement, comme autrefois la métropole envoyait ses bagnards dans les colonies », dénonce l’élue.
Entre insécurité croissante et moyens insuffisants, un sentiment de solitude
Qu’il s’agisse de la Martinique, de la Guyane ou de La Réunion, les constats se ressemblent : un narcotrafic qui s’intensifie, des trafiquants mieux armés, des sociétés fragilisées et des réponses publiques jugées trop lentes ou inadaptées.
Tous les élus ultramarins le répètent : ils sont en première ligne face à une menace qui relève désormais de la géopolitique mondiale. Et tant que l’État continuera de considérer ces territoires avant tout comme de simples zones de transit vers la métropole, la lutte contre le narcotrafic restera incomplète – au risque de laisser s’installer durablement un climat de violence dont les populations paient déjà le prix fort.